Abou El Kacem CHEBBI

Poète tunisien de langue arabe, considéré comme le fer de lance du romantisme en Afrique du Nord, Abou El Kacem Chebbi (également orthographié : Abul Qacem Chebbi), le « Rimbaud du Maghreb », est mort à l’âge de vingt-cinq ans, en 1934, il y a 84 ans. Son pays est indépendant depuis 62 ans ; depuis le 20 mars 1956, lorsque la France a reconnu solennellement l’indépendance de la Tunisie. Habib Bourguiba en devint le premier président de la République en 1957 et ce, jusqu’à la nuit du 6 novembre 1987, durant laquelle un groupe de sept médecins tunisiens signa un rapport médical qui certifia l’incapacité mentale du président. Ce fut un coup d’État. Ben Ali déposa Bourguiba et pris d’une main de fer - qui, jamais, ne desserra - le pays. Et c’est ce Ben Ali, qui, en décembre 2010, est enfin appelé à dégager !
Dès les premiers jours de la Révolution, ce sont ses vers, ses poèmes, que le peuple tunisien reprend en chœur : Réveillez-vous ! – La nuit du sommeil touche à sa fin… Levez-vous comme des lions – Et ne reculez pas car la mort guette la lâcheté. Le poème « Ela Toghat Al Alaam » (« Aux tyrans du monde ») est sur toutes les lèvres. Il a été écrit sous le régime du protectorat français en Tunisie. Chebbi y dénonce la tyrannie à travers les affres du colonialisme français (qui durera de 1881 à 1956) - sans le mentionner ouvertement -, menace les occupants et prédit une révolte contre le système : Prends garde car sous les cendres couve le feu – Et quiconque sème les ronces récolte les blessures.
La poésie de celui qui écrivait avant tout pour son peuple, n’a jamais été aussi vivante et actuelle. Il n’y a pas un cortège, lors des manifestations anti-Ben Ali de décembre 2010 et janvier 2011, qui ne fasse allusion à la poésie d’Abou El Kacem Chebbi, et ce, depuis que Mohamed Bouazizi, un jeune vendeur ambulant de fruits et légumes, s’est immolé par le feu, le 17 décembre 2010, à Sidi Bouzid. La police avait confisqué ses marchandises (le seul revenu de sa famille). Son geste a déclenché la révolution qui va balayer la dictature de Zine el-Abidine Ben Ali (qui pille et étouffe la Tunisie depuis vingt-trois ans), le 14 janvier 2011.
Pourquoi cette révolution ? Parce que les piliers du régime reposaient sur le pillage des ressources du pays par la caste au pouvoir, avec la terreur comme mode de gouvernement du pays et des hommes, la corruption de haut en bas, touchant également les élites de toute tendance et enfin l’absence des libertés combinée avec l’instrumentalisation de la religion, créant ainsi une interférence entre le champ politique et le champ religieux. Tout ceci a généré chez les citoyens tunisiens, un sentiment atroce de frustration, d’humiliation et de mépris. Tous ceux qui agitent des épouvantails pour tenir les peuples sous leur férule ont reçu une alerte de la nation tunisienne.
Il aura fallu attendre l’hiver 2010 pour que les masques et les chaînes tombent en Tunisie, et le 11 février 2011 en Égypte (avec le départ de Moubarak après dix jours de contestation populaire), comme l’avait prédit Abou El Kacem Chebbi, dans son poème « La volonté de vivre », écrit à Tabarka (ville côtière du nord-ouest de la Tunisie), le 16 septembre 1933 : Qui n’aime pas gravir la montagne, - vivra éternellement au fond des vallées. Car la poésie porte le peuple, afin que sa « volonté de vivre » triomphe, sans que les partis politiques et religieux ne se l’approprient.
Que va-t-il se passer en Tunisie et en Égypte, après la révolution et dans les pays voisins ? Personne ne le sait. Huit ans plus tard, le bilan est contrasté. Gibran Khalil Gibran (in Le Prophète, 1923) donne peut-être une piste : « Et s’il existe un despote que vous voudriez détrôner, voyez d’abord si l’image de son trône érigée en vous est détruite. Car comment le tyran peut-il régner sur les affranchis et les fiers, s’il n’existe une tyrannie dans leur propre liberté et une honte dans leur propre fierté ? » Tel est notamment le défi qu’il faudra relever. Chebbi le révolutionnaire, est considéré dans son pays comme le poète national. Cela n’a pas toujours été le cas. Son image figure aujourd’hui sur des timbres, un billet de la Banque centrale. Des rues, des places, un lycée et un prix littéraire portent son nom. Son tombeau a été transformé en mausolée. Un buste de lui, spectaculaire, a été élevé aux environs de Tozeur. Son œuvre est incluse dans les programmes scolaires et universitaires. Une salle du palais présidentiel de Carthage porte son nom. Enfin, les premiers vers de son poème « La volonté de vivre », ont été intégrés à la fin de l’hymne national tunisien.
Abou El Kacem Chebbi est né le 24 février 1909, dans le hameau de Chabbiya, devenu aujourd’hui l’un des quartiers de Tozeur (correspondant au lieu-dit Ras El Aïn), ville du Sud de la Tunisie et opulente oasis. Chebbi naît dans une famille aisée. Son père, cheikh Mohamed Ben Belgacem Chebbi est un cadi, soit un juge musulman remplissant des fonctions civiles, judiciaires et religieuses. La famille devra se déplacer à travers le pays, en raison des affectations successives du père qui, confesse le poète : « Il m’a fait saisir le sens de la bonté et de la tendresse, et m’a appris que la vérité est la chose la meilleure dans ce bas monde, et la chose la plus sacrée dans l’existence. » Chebbi écrit ses premiers poèmes à l’âge de quatorze ans et reçoit une éducation traditionnelle à l’école primaire coranique, puis de 1920 à 1928, à l’Université Zitouna de Tunis, le plus ancien établissement d’enseignement du monde arabe, puisqu’une médersa y fut fondée dès 737.
À l’Université, il apprend le Coran et lit les poètes arabes classiques. Chebbi va vivre dans des médersas pendant dix ans, toute son adolescence, dans des conditions difficiles, avec une santé précaire. Depuis l’enfance, il est atteint de rhumatisme articulaire : Je vivrai malgré la maladie et les ennemis, - Comme l’aigle sur la plus haute cime. Plus tard dans son Journal, il jugera avec sévérité et mépris « cet enseignement sclérosé » et ailleurs encore : Qu’est-ce donc cette vie si ennuyeuse ? – Cette vie n’est qu’un ennui qui se répète – Un matin qui recule devant la nuit. Si la lumière, dans toutes ces déclinaisons compte autant, et si présente chez Chebbi, c’est bien pour arracher le jour à la nuit obscurantiste : Vous ne dites plus rien, protecteurs de la religion ! – Vous dormez profondément alors que le torrent avance – Vous ne dites plus rien, drapés dans des tenèbres – Dont les replis sont chargés – De signes de blasphèmes et de superstitions.
Dès 1927, Chebbi fréquente assidument les bibliothèques de la Khaldounia (la première école moderne de Tunisie, fondée en 1896 à Tunis), du club littéraire An-Nâdi Al Arabi (Foyer arabe), du club littéraire de l’Association des anciens élèves du collège Sadiki. Au sein de ce dernier - qui est le premier lycée secondaire moderne de Tunisie, situé dans la kasbah de Tunis -, Chebbi accède à la traduction, en arabe, de certaines œuvres de Bernardin de Saint-Pierre, Chateaubriand, Coppée, Lamartine, Hugo, Vigny, Musset, Nerval, Goethe, Keats ou Gide. Ces lectures vont l’influencer durablement et en profondeur.
Ne pas oublier que Chebbi s’inscrit pleinement dans le mouvement de la Nahda (concept traduisible par renaissance, laquelle succèderait à des siècles de décadence), un mouvement transversal de renaissance arabe moderne, à la fois littéraire, politique, culturelle et religieuse. Initialement, cette mouvance, qui se situe entre les dernières décennies du XIXe siècle et les trois premières décennies du XXe siècle, est liée à la décomposition politique de l’Empire ottoman et au moment de réinvention identitaire du monde arabe qui l’accompagne. Au début du XXe siècle, quand on parle des « Arabes », il ne s’agit pas seulement des Bédouins ou des descendants d’une tribu de la péninsule arabique, mais aussi d’un groupe national uni par sa langue, écrit l’historienne Anne-Laure Dupont (in Le Monde diplomatique, août 2009). Le mot nahda exprime l’idée d’un renouveau civilisationnel et d’un (r)éveil des Arabes en tant que nationalité. En une vision arabo-centrée de la civilisation islamique, largement empruntée aux orientalistes et aux discours des idéologues de la fin du XIII siècle, il en vient à désigner une période de l’histoire dont le début est symboliquement fixé à l’expédition de Bonaparte en Égypte : une conquête violente, qui a provoqué les « germes de la civilisation » et encouragé les Arabes à les faire fructifier. Le concept de nahda apparaît alors comme l’expression nationale arabe du projet civilisateur des Lumières et des entreprises coloniales. Il est aussi une acculturation des réformes ottomanes. Les Arabes souhaitent y être associés et recueillir pleinement les fruits de la civilisation dont Istanbul leur paraît désormais une vitrine, comme Paris ou Londres.
Faisant alors son apparition, l’expression de « monde arabe » dessine un nouvel horizon aux arabophones vivant sous les souverainetés ottomane, française ou britannique. La Première Guerre mondiale et la défaite ottomane en 1918 inaugurent ce que les historiens arabes appellent la « seconde nahda ». C’est le temps de la fondation des États arabes modernes, des luttes pour l’indépendance, de la remise en cause de l’identité française de l’Algérie, de la théorisation du nationalisme arabe. Les polémiques font rage parce que, si le mot nahda est désormais sur toutes les lèvres, les appréciations de ce que doit être une renaissance varient en fonction du degré de rupture avec la tradition que l’on est prêt à accepter et de la place qu’on assigne à l’islam dans le modelage des sociétés modernes. Le mouvement réformiste du XIXe siècle nourrit aussi bien l’idéalisation des pieux ancêtres (les salaf) et le militantisme des Frères musulmans (1928) que l’acceptation d’une laïcité allant de pair avec l’approfondissement des valeurs spirituelles et humanistes de l’islam. La « Renaissance » est islamique autant que laïque. Du moins, dans un premier temps. Aujourd’hui, il en va hélas autrement.
La Nahda évoque la revendication de la liberté en littérature, l’émergence de l’idée de nation, la redécouverte d’un passé médiéval idéalisé, le conflit de générations et la crise de l’autorité, la prédominance du modèle constitutionnel en matière politique. Porteur d’une tension constante entre ouverture à l’autre et retour sur soi, entre libération et réaction diversifiée à l’« occidentalisation », la Nahda aussi une forte composante identitaire. Un terreau en pleine ébullition, donc. La lumière va-t-elle prendre le pas sur l’ombre ? Non, ce sont encore les obscurantistes qui l’emportent. Chebbi lui-même en a fait les frais : Combien de fois – Parmi les hommes – Un prophète est venu – Prêcher la vérité – N’a récolté auprès d’eux – Que les pires insultes – Les plus hostiles protestations : - « Au bûcher ! L’âme de ce malin – Ne mérite que les flammes ! » - Puis l’ont jeté dans le brasier – Ils ont continué ainsi – A perpétrer la terreur et le mal – Partout dans le monde…
C’est dans le contexte de la Nahda, qu’aux romantiques, parnassiens et symbolistes européens, mais aussi aux poètes arabes classiques, que s’ajoute une troisième influence chez Chebbi ; celle des auteurs du Mahjar (diaspora), dont le principal représentant n’est autre que le Libanais maronite Gibran Khalil Gibran, dont l’œuvre la plus connue est bien sûr Le Prophète ; un livre publié en 1923 en anglais (Gibran vivait en exil, aux États-Unis, à Boston, à l’époque la deuxième plus grande communauté syro-libanaise), au sein duquel se succèdent vingt-six chapitres qui abordent quelques-uns des grands thèmes de la vie humaine : « Fiez-vous aux rêves car en eux est cachée la porte de l’éternité. » Œuvre d’un homme partagé entre Orient et Occident, installé aux Etats-Unis et rêvant du Liban : Gibran fait de son Prophète un véritable plaidoyer pour l’humanisme ; une leçon de « pouvoir-être » et de « savoir-exister ».
À l’université, Chebbi milite au sein de l’Association des jeunes musulmans et est élu président du comité des étudiants. Il se distingue en proclamant la nécessité de rénover et de moderniser la société comme l’enseignement scolastique : « Il faut se révolter contre ce qui existe, et surtout contre ceux qui détestent la lumière. » Le poète vise aussi bien les musulmans intégristes que le colonialisme français. C’est en 1881, que les troupes françaises ont débarqué sur le territoire de la régence de Tunis, alors sous domination de l’Empire ottoman (depuis la conquête de Tunis en 1574), et instaurées, à la fin des combats et de la répression des révoltes, un protectorat. Dans les années 1924-1930, la lutte sociale menée par les ouvriers tunisiens contre leurs patrons européens et le gouvernement du protectorat, allait s’accentuant. La prise de conscience ouvrière et nationale devint plus nette. Les libertés de pensée, d’expression et de réunion étaient interdites. La liberté de la presse était extrêmement réduite. Du point de vue économique, la situation était tout aussi critique. Les ouvriers agricoles étaient sous-payés. Le commerce était accaparé par une poignée de spéculateurs, encouragés par le régime colonial. Le chômage était de règle. Dans un contexte de difficultés économiques et sociales engendrées par le krach de 1929, le mouvement nationaliste gagne en vigueur et en audience auprès d’une population confrontée à une forte croissance démographique, surtout au sein de la population musulmane, et à une hausse du chômage découlant du manque de déboucher. Figure de la génération montante, l’avocat Habib Bourguiba fustige dès 1930, le régime du protectorat et déclare : « La Tunisie que nous entendons libérer ne sera pas une Tunisie pour musulmans, pour Juifs ou pour chrétiens. Elle sera la Tunisie de tous ceux qui, sans distinction de religion ou de race, voudront l’agréer pour leur patrie et l’habiter sous la protection de lois égalitaires. » Le peuple est à l’agonie. Chebbi écrit : La paix est une vérité étrangère – Et la justice la philosophie du feu qui couve. – Il n’y a de justice que lorsque les forces s’équilibrent – Et que la terreur affronte la terreur. Abou El Kacem Chebbi est le poète du peuple : Tu es né sans chaînes comme la brise qui passe – Et libre comme la clarté du matin dans le ciel – Pourquoi acceptes-tu donc l’humiliation des chaînes ? – Pourquoi baisses-tu le front devant ceux qui t’ont enchaîné ? – Allons, lève-toi et marche sur le sentier de la vie – Car la vie n’attend point celui qui dort.
Ayant achevé avec succès ses études secondaires en 1928, Chebbi s’inscrit à l’École de droit tunisien. Il fréquente désormais les réunions et les cercles littéraires. Dandy, pour affirmer sa différence, Chebbi s’habille avec élégance et ne porte pas les insignes obligatoires des bacheliers ès sciences théologiques. Le 1erfévrier 1929, à la Khaldounia, Chebbi donne une conférence retentissante de deux heures sur le thème de « l’imaginaire poétique et la mythologie arabe ». Il n’aspire pas seulement à libérer son peuple (du joug colonial français), mais également la culture et la langue : « Nous désirons ardemment aujourd’hui créer une littérature nouvelle, éclatante, qui exprimera la vie dans sa complexité, l’espoir et les sentiments qui bouillonnent en nous, les palpitations de notre cœur et les élans de notre âme… une littérature solide, profonde, conforme à nos aspirations et répondant à nos goûts et à notre vie actuelle… Nous, fils de la vie, devons maintenir la littérature dans un idéal réaliste. Nous ne concevons la littérature ancienne que comme les choses que l’on admire ; nous ne nous permettrons point de passer de l’admiration béate à l’imitation, car chaque époque a sa vie propre qu’elle doit vivre, et chaque société a sa littérature qu’elle gonfle d’une vie nouvelle… Je dis cela en faisant fi de ce que peuvent penser ceux qui préfèrent vivre dans les ténèbres des siècles passés et tourner le dos à la vie créatrice… » Son exposé dresse une rude critique de la production poétique arabe.
Ce jeune homme de vingt ans, aussi billant poète qu’intellectuel, est rôdé au débat comme à la critique, dont il nous dit (in Journal), s’opposant encore en cela aux obscurantistes de tous bords : « Je ne suis pas de ceux pour qui la critique n’est qu’hostilité et injures ; et qui n’entreprennent d’écrire que mus par un vil objectif et un but peu louable. Dieu merci, je n’en fais pas partie. Bien au contraire, je suis de ceux qui, écoutant un discours en retiennent le meilleur ; ceux qui se réjouissent de toute critique ayant la vérité pour seul but et la sincérité pour souci unique. » Mais Chebbi ne parle que l’arabe. Il souffrira de ne pas parler une autre langue, écrivant notamment : « Je suis comme un oiseau n’ayant qu’une seule aile, une aile aux plumes arrachées » ou « Je ne peux planer dans le monde de la littérature avec une seule aile emplumée. » Il n’a jamais quitté la Tunisie. Mais ce jeune homme surprend par l’originalité de ses idées, autant qu’il scandalise par l’audace de ses jugements : « Les poètes arabes n’ont jamais exprimé de sentiments profonds, car ils ne considéraient pas la nature avec un sentiment vivant et méditatif, comme quelque chose de sublime, mais plutôt comme on regarde d’un œil satisfait un vêtement bien tissé et coloré ou un beau tapis, rien de plus. » Chebbi poursuit : « Les Arabes n’ont comme expression de la beauté, que celle de la femme… Le poète arabe ne l’évoque qu’en tant qu’objet de son désir et de sa convoitise charnelle... La vision de la femme dans la littérature arabe est une vision médiocre, très basse et complètement dégradée. » Sa conférence déclenche, d’abord en Tunisie puis au Proche Orient, une série de réactions violentes, notamment de la part des conservateurs et des poètes salafistes (issus d’un mouvement sunnite revendiquant un retour à l’Islam des origines, fondé sur le Coran et la Sunna). Abou El Kacem Chebbi écrit dans son Journal : « Dans cette causerie, j’ai exprimé des idées qui ne furent pas admises par de soi-disant hommes de lettres, les considérant comme une rébellion contre la littérature arabe et une ingratitude à l’égard du mérite des Arabes. Cette tendance prit de l’ampleur et donna l’occasion à de fausses nouvelles et des rumeurs au point que certains imposteurs crièrent à l’impiété et à l’athéisme. D’aucuns, mal intentionnés, ont saisi cette occasion pour ternir l’image du Club et l’accuser d’égarement et d’athéisme. C’est en effet ainsi que les pêcheurs en eau trouble prennent plaisir à asséner des coups à toute entreprise qu’ils décident de détruire en pays d’Islam. D’où ses grandes campagnes ourdies contre le Club et qui, à mon grand étonnement, ont été fatales à ses activités. Ces campagnes découragèrent la plupart des membres du Club, les remplirent de peur, de frayeur, de lâcheté. Ils cessèrent de s’y rendre, sauf un ou deux, dotés d’une réelle volonté et d’un courage moral qui fait fi des cris de guerre et méprise les flèches des adversaires. Même ces deux membres-là cessèrent d’y aller. »
Les propos de Chebbi sont pour le moins prémonitoires, au regard de l’islamisme politique à venir, qui annoncera le temps des égorgeurs. Le soufisme auquel se rattache Chebbi et qui fait partie de son héritage culturel et familial, en sera d’ailleurs l’une des victimes. Les extrémistes musulmans reprochent aux soufis de gommer la distinction – fondamentale dans l’islam – entre Dieu et l’homme. En effet, le but déclaré du soufi est de s’immerger en Dieu au point de ne plus faire qu’un avec lui. Dans cette branche traditionnelle de l’islam, qui n’a pas échappée elle-même aux multiples déviations du charlatanisme, maraboutisme et autres fakirs – aussi bien sunnite que chiite – qu’est le soufisme (le mot viendrait de l’arabe safa : « limpidité »), ses adeptes cherchent un chemin spirituel personnel, jalonné d’expériences mystiques, d’élévation, voire d’ascèse. Le soufisme est un courant ésotérique et initiatique, qui professe que toute réalité comporte un aspect extérieur apparent (exotérique ou zahir) et un aspect intérieur caché (ésotérique ou batin). Il se caractérise par la recherche d’un état spirituel qui permet d’accéder à cette connaissance cachée. Tourné vers l’autre, cet islam est aux antipodes de celui prôné par les islamistes, qui lui reprochent sa dimension ésotérique et son caractère hérétique, et pour tout dire : tout simplement d’exister. La poésie était, dans l’optique des soufis, écrit Mohamed Hassen Zouzi-Chebbi (in La philosophie du poète, 2005), le meilleur moyen de véhiculer leur enseignement et de témoigner de leurs expériences spirituelles. L’inspiration prend chez eux la forme d’une illumination extatique fulgurante et fugitive que seul le génie talentueux peut ensuite traduire en myriades de constellations de mots, d’allusions, de métaphores. Cet enfouissement dans la langue poétique leur valut, de la part des musulmans orthodoxes, au même titre qu’à la poésie en général une forte suspicion et méfiance pour motif d’ésotérisme.
Poète et influencé par le soufisme, Chebbi aspire à une littérature qui corresponde à la vie : « Je suis un poète. Or le poète a sa manière propre d’appréhender la vie. » Cette conférence consomme le divorce inéluctable avec l’ancien. Le poète précise néanmoins : « Si j’appelle de mes vœux le renouveau, ce n’est point pour dénigrer la littérature de nos ancêtres ». Chebbi définit la poésie comme « un cri de l’âme triste », « la beauté des lumières crépusculaires », « l’inspiration de la vie et le langage des anges. » L’édition de sa conférence, par souscription, est un succès. Il s’agit du premier texte ayant formulé de violentes critiques à l’égard de l’art sacré dans la littérature arabe. Chebbi envisage, dans la foulée, de faire paraître un recueil de poèmes intitulé Aghani al-Hayat (Les Chants de la vie) : Que n’ai-je, ô mon peuple, la force des tempêtes ! - Je te jetterais alors la révolte de mon âme. - Que n’ai-je la force des cyclones lorsqu’ils rugissent ! - Par son souffle, je saurais t’inviter à la vie. Ce diwan (recueil de poèmes en langue arabe ou persane) ne sera pas publié de son vivant.
Sa santé, qui a toujours été fragile, se dégrade. Un médecin diagnostique une asthénie physique et morale. En juillet 1929, vers la fin du mois, son père, mourant, retourne à Tozeur et promet la main de son fils à l’une de ses cousines, que le poète épousera en 1930 et avec laquelle il aura deux enfants : « Et voici la jolie femme que la vie a fait pousser sur mon chemin, me fixant de ses beaux yeux rêveurs et angéliques. Elle tend vers moi une main douce et enchanteresse, aux doigts effilés couleur de rose, et, de ses lèvres nourries au nectar de la vie, elle imprime sur ma bouche un baiser voluptueux et enivrant. » Son père meurt le 8 septembre 1929. Chebbi est bouleversé : « Et voilà qu’il se retourna vers moi, me fixant du regard. Je crus comprendre qu’il voulait s’adresser à moi. Je m’approchai de lui en l’appelant : Père ! Père ! Que désires-tu ? Hélas ! C’était le dernier regard. Je ne le savais pas… Son cou s’amollit, son regard s’immobilisa, ses lèvres balbutièrent la « chahada » (la profession de foi) qu’il ne cessait guère de répéter. Il rendit le dernier soupir. » Décembre 1929, un foyer de peste éclate dans le sud de la Tunisie. Chebbi écrit son poème « Ô mon frère » : La vie n’attendra pas celui qui dort.
Le 13 janvier 1930, le poète donne une nouvelle conférence à la médersa Slimania (école coranique et centre culturel de la médina de Tunis), sur le thème de la littérature maghrébine. Boycottée par ses adversaires, les oulémas zitouniens (ceux qui ont acquis le « savoir » fondamental dans la communauté, c’est-à-dire la connaissance matérielle du Coran et des traditions prophétiques) et les conservateurs, cette conférence est un échec. La salle est quasiment vide. Chebbi écrit : « J’ai perdu tout espoir quant aux projets tunisiens. J’en veux aux Tunisiens, car ils parlent beaucoup et agissent peu. Ils sont forts pour exposer leurs idées et leurs théories. Leur enthousiasme en l’occurrence fait naître de grands espoirs… mais la triste vérité apparaît au grand jour. De même le vernis de la jeunesse, la fausse fraicheur juvénile laissent place aux rides de la vieillesse et au silence de la mort. Les Tunisiens, aujourd’hui, ont de larges et vastes théories, mais ils évoluent dans un champ d’action étroit et quasiment improductif. » Le poète se retranche auprès de ses amis du groupe Taht Essour (« sous les remparts »), un rassemblement d’artistes et d’intellectuels tunisiens, qui se réunit dans un café homonyme du quartier populaire de Bab Souika (contre les remparts de la médina de Tunis). Tahar Bekri a décrit (in Le goût de Tunis, Mercure de France, 2007) le groupe en ces termes : Chansonniers, journalistes, libres-penseurs, anticonformistes, désargentés, pessimistes et désespérés de leur état mais qui se vengeaient de l’adversité par l’ironie et l’humour noir... rien n’échappait à leur regard satirique. »
Chebbi collabore aussi à la revue Al-âlam al-adabi (Le Monde littéraire) et au supplément littéraire d’En Nahda. La revue cairote Apollo publie également ses poèmes. La nouvelle version de ses Cantiques de la vie, ne peut toujours pas paraître, comme la première, par manque de souscripteurs. Chebbi, qui souffre de l’indifférence de ses compatriotes (« Chaque jour ma solitude est plus grande parmi les êtres humains, et je prends davantage conscience du sens profond de cette douloureuse solitude… Je m’aperçois que je suis étranger parmi mes compatriotes »), est en proie à des crises d’étouffement. On parle alors de myocardite et de tuberculose. Dans son Journal, Chebbi écrit : « Nous en sommes, ici-bas, que des instruments à code qu’une seule main fait vibrer, tout autant la fleur vive, la vague fougueuse ou la gracieuse courtisane, pour produire une mélodie à timbres variés mais exprimant les mêmes thèmes. En d’autres termes, nous formons une unité universelle agitée par les vagues de la vie, quand bien même les moules dans lesquels nous avons été coulés sont différents. C’est la raison pour laquelle j’éprouve à l’égard de la fleur vive la même tendresse que pour l’homme. »
Diplômé en 1930, il envisage d’effectuer un stage d’avocat au tribunal de la Driba, mais doit, par obligation, retourner à Tozeur, en 1931, pour s’occuper de sa famille (sa mère, ses frères et son épouse), dont il a la charge depuis la mort de son père, en 1929. Les deux dernières années qu’il lui reste à vivre, sont, malgré la solitude et la maladie, très prolifiques : Je vivrai malgré la maladie qui me ronge - Et les ennemis qui m’assaillent. Bien qu’élevé dans un arabe littéral, Chebbi, poète du peuple, grand lecteur de la poésie arabe classique, mais aussi des romantiques et symbolistes européens, apprécie le parler populaire tunisien et n’hésite pas à déclarer, à propos des partisans de l’arabe classique : « Ils sont prisonniers d’un grand nombre de clichés et de contraintes poétiques qui les forcent à imiter les anciens, ils écrivent une langue qui n’est pas la leur. » Chebbi s’exprime dans un langage neuf, qui rompt avec une tradition séculaire. « Le poète s’appartient à lui-même, écrit-il. Il se soumet à la vie et non à ce que lui dictent les hommes. » Chebbi « pense et imagine sa poésie comme un souffle salutaire opérant tel un talisman une catharsis et dégageant l’ardeur du désir de vie », écrit Mohamed Hassen Zouzi-Chebbi (in La philosophie du poète, 2005).
Poète du moi perdu et assoiffé, de la Tunisie et de l’universel, écrit : Ma poésie est le soupir de mon âme – Lorsque mes sentiments s’y manifestent. – Sans elle ne se seraient pas dissipées – Les nuées dangereuses de la vie au-dessus de moi. – Et je n’aurais rencontré ni ma mélancolie – Ni ma joie. Poète de l’amour, de la solitude, de la liberté et de la révolte ; Chebbi écrit encore le poème « Dit de mon cœur à Dieu », qui résume à lui seul son romantisme, lequel n’est pas une copie de ce qui s’est fait et se fait en Europe, mais un romantisme personnel, actualisé, qui ne fait pas fi des acquisitions du symbolisme et de la poésie arabe : J’ai poussé mes branches dans les monts des soucis ; - Elles se sont balancées avec peine parmi les rochers. – Le brouillard m’a couvert ; mes feuilles – Et mes fleurs parurent et je fus seul devant les tempêtes. – J’ai chanté, glorifiant la vie et le désir – Mais les ouragans n’ont pas compris mon intention. – Ils ont jeté dans les précipices mes vertes ramures, - Et ont continué à creuser ma tombe dans la neige. – Ils ont emporté la senteur et je me dis alors : - Par ce parfum, ils vont édifier ma gloire dans les pâturages du ciel. – J’ai chanté amoureusement la beauté du printemps et de l’aube, - Que fera donc le vent après moi ? Chebbi est animé par un « rêve de changement, de reconsidération de la condition humaine », par le « combat envers tout ce qui pourrait priver l’homme d’évolution. » Et si sa poésie demeure classique dans la forme, le fond est novateur pour l’époque : Je voudrais n’avoir jamais cessé d’être ce que j’étais, - Une lumière libre répandue sur toute l’existence. Chebbi n’offre pas pour autant une vision pessimiste du monde, car : La vie prévaut sur la douleur. Chebbi, qui n’a pas connaissance du surréalisme, ajoute pourtant : « Le rêve est en rapport direct avec la vie qui se présente à nous sous forme de désirs à l’état d’éveil et de songe à l’état de sommeil. Les désirs accumulés dans l’inconscient sont inéluctablement appelés à resurgir comme phénomène réel, ne serait-ce que dans le monde des rêves. »
Alors que son second fils naît en janvier 1934, Chebbi écrit, en février, « L’Aveu », puis « Le Cœur du poète », en mars, et son célèbre « Ela Toghat Al Alaam » (« Aux tyrans du monde »), en avril. La maladie progresse en lui.
Le 3 octobre, il est admis à l’hôpital italien de Tunis pour une myocardite. Pendant ce temps, à Tunis, le leader indépendantiste tunisien Habib Bourguiba (qui sera le premier président de la République de 1957 à 1987), a demandé la souveraineté nationale et l’avènement d’une Tunisie indépendante. Il a été arrêté et placé en résidence surveillée avec d’autres indépendantistes. Des émeutes éclatent aussitôt partout dans le pays, alors qu’Abou El Kacem Chebbi meurt, au matin du 9 octobre 1934. Il est à peine âgé de vingt-cinq ans, laissant cent trente-deux poèmes, un journal, des lettres et des articles parus dans différentes revues d’Égypte et de Tunisie. Ses Chants de la vie ne paraîtront qu’en 1955, au Caire, vingt et un ans après sa disparition : Ni les vagues du désespoir - ni les malheurs soufflant en tempête - n’éteindront les flammes qui circulent dans mes veines.
Christophe DAUPHIN
(Revue Les Hommes sans Épaules).
A lire : Diwane des Cantiques de la Vie (éd. Arabesques, 2017), Abû-l Qâsim Al-Shebbi, choix de poèmes, calligraphies de Amor Jomni, édition trilingue arabe, français, anglais, (éd. Nirvana, Tunis, 2009), Journal (Fondation Nationale Carthage, 1988), Poèmes (éd. Seghers, 1959).
A consulter : Ali Chebbi, Amour et aubes lumineuses, Abou El Qacem Chebbi (éd. Arabesques, 2016), Mohamed Ameur Ghedira, Chabbi ou le Mal de vivre (éd. du Centenaire, Tunis, 2009), Mohamed Hassen Zouzi-Chebbi, La Philosophie du poète. L’exemple d’un poète tunisien de langue arabe - Abul Qacem Chabbi (L’Harmattan, 2005), Abderrazak Cheraït, Abou el Kacem Chebbi (éd. Appolonia, Tunis, 2002).
Publié(e) dans la revue Les Hommes sans épaules
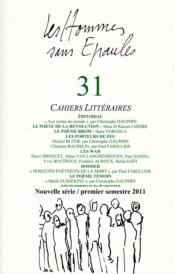
|
||
| Dossier : HORIZONS POÉTIQUES DE LA MORT n° 31 | ||
